Qu'est-ce que la post-vérité?
Découvrez notre blog dédié à la réflexion sur la société contemporaine. Nous vous offrons des analyses approfondies et des résumés d'ouvrages pertinents pour vous éclairer sur les enjeux actuels.

La colère comme l'une des émotions possibles (et probables!) à la base de la post-vérité
Popularisé par les dictionnaires Oxford qui l'ont désigné mot de l'année 2016, le terme "post-vérité" décrit une situation où l'opinion publique est davantage influencée par les émotions et les convictions personnelles que par les faits objectifs. Cette définition souvent citée suggère que la vérité n'est pas nécessairement niée, mais plutôt reléguée au second plan, voire éclipsée ou considérée comme non pertinente. Le préfixe "post" indique ainsi une perte de centralité de la vérité factuelle plutôt qu'une simple succession ou séquence temporelle. Il s'agit donc d'un contexte où la distinction entre le vrai et le faux tend à s'estomper ou à être intentionnellement brouillée par certain acteurs politiques. Nous verrons plus loin que la post-vérité peut être définie comme un syndrome complexe dont l ‘origine comprend de multiples facteurs : historiques, philosophiques, psychologiques, technologiques, sociaux et politiques.
La grande question d'aujourd'hui est de savoir si la démocratie peut survivre en ces temps de grande confusion où vérité et post-vérité s'entremêlent au quotidien dans les débats et la discussion politico-médiatique de nos sociétés fragmentées à l'excès. Si le mensonge et la manipulation politique sont des phénomènes anciens comme nous le rappelle Sophia Rosenfeld dans son ouvrage Democracy and Truth, A Short History, sa particularité contemporaine résiderait dans l’impact des technologies de communication du XXIe siècle (réseaux sociaux, « chambres d’échos », algorithmes), la vitesse et l’échelle sans précédent de la circulation de l’information (et de la désinformation). Pour Michael Patrick Lynch, la réponse est sans équivoque : la démocratie ne peut survivre sans la vérité comme fondement d’une société qui se veut un espace de raison plutôt qu’un simple champ de bataille du pouvoir.
La post-vérité s'inscrit donc dans un contexte plus vaste de "crise de la vérité". Cette crise se manifeste par une perte graduelle des points de repère et des références partagées, pourtant essentiels à la cohésion sociale. On observe en parallèle une diminution significative de la confiance envers les institutions traditionnellement garantes de la vérité ou de sa validation, comme les médias, l’expertise scientifique [1] et les gouvernements.
Un autre élément important du contexte est la montée du populisme dans certains pays du monde. [2] Le populisme prospère dans un environnement de post-vérité : les leaders populistes exploitent la méfiance envers les institutions et les faits objectifs pour diffuser leur propre récit, souvent basé sur des émotions intenses et des simplifications outrancières. [3] Ils peuvent ainsi discréditer les critiques et les informations factuelles et scientifiques qui contredisent leur discours.
Notes
[1] L'autorité des experts est remise en question, ce qui engendre une inquiétude générale quant à la fiabilité des informations présentées et débattues publiquement. Voir à ce sujet Gloria Origgi, La vérité est une question politique, Albin Michel, Paris, 2024, pp. 34-118.
[2] Voir à ce sujet notamment pour des études de cas régionales : Cristobal Rovira Kaltwasser et al. (ed.). (2017). The Oxford Handbook of Populism, Oxford University Press, Oxford, pp. 101-248.
[3] Dans son ouvrage influent, Qu'est-ce que le populisme ? (What is Populism?), Jan-Werner Müller soutient que le populisme se caractérise par un rejet de l'establishment et une affirmation que seul "le peuple" authentique détient la véritable volonté politique. Cette logique populiste entretient un rapport problématique avec la vérité de plusieurs manières qui convergent avec le concept de post-vérité.
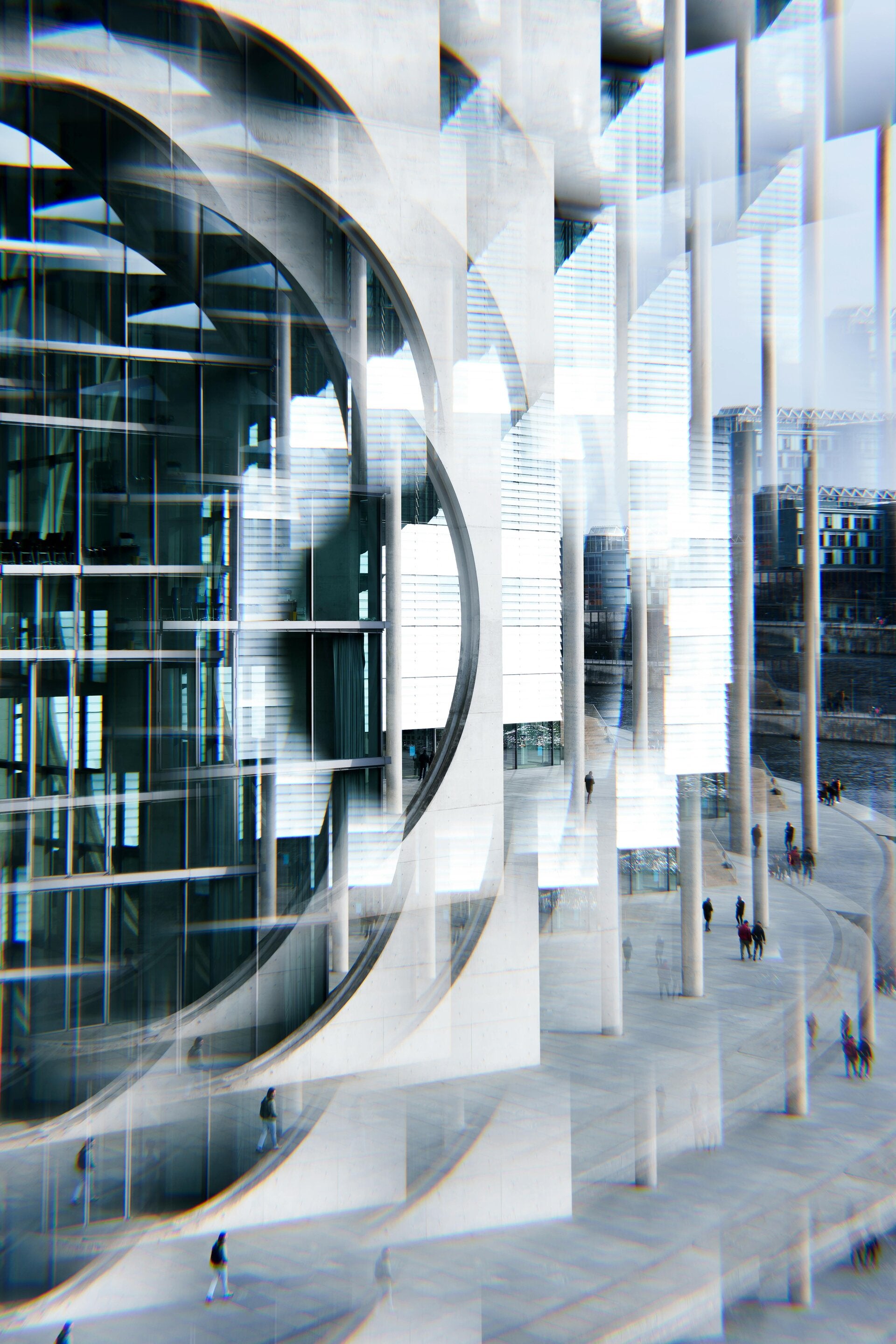
Réflexions sur nos démocraties
Notre blog se distingue par son approche informative et ses résumés d'ouvrages clés, offrant une perspective unique sur les défis contemporains. Nous visons à stimuler la pensée critique et à encourager un engagement éclairé dans le monde qui nous entoure.
Les démocraties sont confrontées à une double crise inter-reliée : une érosion profonde de la confiance dans leurs propres systèmes de gouvernance et une perception croissante selon laquelle la politique ne serait qu'une question de pouvoir, et non de vérité. Cet environnement délétère est propice à la prolifération de « grands mensonges, de déni et de théories du complot ».
Des auteurs nous parlent de la vérité comme fondement de la démocratie. Mais qu’est-ce que la vérité en politique ? Est-elle une donnée objective à découvrir, une norme idéale à poursuivre, une construction dépendante des conventions ou bien un instrument au service du pouvoir? On peut déjà déceler dans ce questionnement un paradoxe que l'on tentera de résoudre: comment qualifier ce choc entre la vérité, souvent associée à l'objectivité et à l'universalité, et le monde de la politique, soumis à la contingence, aux rapports de force, à la pluralité des opinions et aux exigences de l'action dans un monde imparfait? Pour Hannah Arendt, "La véracité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques". [1]
La théorie politique soutient que la démocratie fonctionne de façon saine et efficace quand les citoyens peuvent prendre des décisions basées sur des informations véridiques et fiables. Mais cela semble de plus en plus improbable dans un certain nombre de sociétés plongées dans l’ère numérique. [2]
Pour exercer leur jugement rationnel, les citoyens doivent avoir accès minimalement à la vérité factuelle sur les enjeux politiques et en lien avec les actions de leurs représentants. La confiance dans les institutions démocratiques dépend aussi de la fiabilité de l'information en soi et telle que perçue par les citoyens. Lorsque cette confiance s'érode, les fondements mêmes de la démocratie peuvent être fragilisés. C’est ce qui se produit globalement dans l’ère de la post-vérité. Hannah Arendt avertissait déjà que la perte de la capacité à distinguer les faits de la fiction constituait un trait caractéristique du maintien des régimes totalitaires, ce qui peut nous éclairer sur les démocraties qui glissent vers plus d’autoritarisme. [3]
Notes
[1] Hannah Arendt, "Du mensonge en politique", Du mensonge à la violence, Paris: Calmann Lévy, 1972, p. 9.
[2] La théorie de l'agir communicationnel et l'éthique de la discussion développées par Jürgen Habermas reposent sur la conviction de la possibilité d'un consensus rationnel et intersubjectif sur les normes et les vérités. L'auteur avance que des institutions et des processus de communication exempts de contraintes, où les arguments sont librement échangés et examinés, sont indispensables à la légitimation des décisions politiques et à la convergence vers une forme de vérité ou de validité partagée. Abordant le tournant de la transformation structurelle de l'espace public numérique, Habermas observe que les réseaux sociaux ont effacé la délimitation constitutive entre la sphère privée et la sphère publique pour de nombreux utilisateurs. Contrairement à l'espace public traditionnel où la parole publique était médiatisée et soumise à des critères de vérité, de rationalité et de cohérence logique par les médias, dans l'espace numérique, chaque individu peut devenir instantanément un "auteur" public. Voir en particulier son ouvrage Espace public et démocratie délibérative : un tournant, (2022). Gallimard.
[3] Dans son livre The Origins of Totalitarianism (1951), Arendt met en lumière la perte de la distinction entre les faits et la fiction en régime totalitaire. Arendt y démontre que la propagande totalitaire réussit à imposer une réalité alternative en brouillant intentionnellement les frontières entre le vrai et le faux. Cette confusion n'est pas seulement une tactique de manipulation, mais une condition nécessaire au maintien du pouvoir. Pour Arendt, la personne la plus vulnérable au totalitarisme n'est pas l'adhérent convaincu, mais celle qui a perdu la capacité de distinguer la réalité de la fiction et la vérité du mensonge, la rendant ainsi susceptible à l'endoctrinement et à l'acceptation du monde fabriqué par l'idéologie. Voir l’édition de 2024, The Origins of Totalitariansim, Partie 3, «Totalitarianism», pp. 325- 518, Marmer Books Classics.

Engagez-vous!
Nous espérons que notre contenu suscitera des réactions et des discussions constructives. Partagez vos commentaires et contribuez à enrichir le débat sur la valeur de la vérité en politique.
La vérité comme condition de survie de la démocratie
Michael Patrick Lynch, philosophe contemporain et professeur émérite à l'Université du Connecticut, consacre ses recherches à l'intersection cruciale de la vérité, de la démocratie et de l'épistémologie de la technologie. Son plus récent ouvrage, De la vérité en politique : Pourquoi la démocratie l'exige (2025), lance un appel urgent : la vérité, souvent malmenée dans la sphère politique, est pourtant une condition sine qua non à la survie même de nos démocraties. Lynch y diagnostique une double crise qui ébranle les fondements démocratiques actuels : d'une part, une confiance érodée dans les systèmes démocratiques eux-mêmes, et d'autre part, une perception grandissante de la politique comme une simple arène de pouvoir, dénuée de toute quête de vérité.
Face à ce double constat alarmant, il affirme avec force que les croyances politiques non seulement peuvent, mais doivent être soumises à une évaluation rigoureuse en termes de critères de véracité ou de fausseté. Pour que la démocratie puisse se maintenir comme un « espace de raison » plutôt qu'un simple « champ de bataille du pouvoir », Lynch souligne l'impératif de forger une « infrastructure de la connaissance » plus résiliente, ce qui implique un renforcement stratégique des institutions éducatives et médiatiques, ainsi qu'un engagement renouvelé envers les disciplines scientifiques et historiques.
Au cœur de l'œuvre de Lynch réside une thèse audacieuse : la vérité n'est pas une simple commodité politique, mais une condition sine qua non pour la viabilité de la démocratie. Il s'emploie à défendre cette position fondamentale face aux multiples contestations philosophiques et aux courants contemporains qui, insidieusement, relèguent la vérité au second plan du débat public. Pour ce faire, il entreprend une exploration rigoureuse des diverses interprétations philosophiques de la vérité – des préceptes platoniciens aux perspectives pragmatistes de Dewey, en passant par les théories de la justice de Rawls – les contextualisant au sein de la politique démocratique actuelle, dans le but explicite de redéfinir et de réhabiliter le concept de vérité au sein du discours politique moderne.
Dans le chapitre intitulé « La vérité peut-elle être une valeur démocratique? », Lynch propose une définition précise de la vérité politique, la caractérisant comme une « norme constitutive de la croyance ». Une déclaration politique doit viser à être une croyance vérifiable et non une simple expression d’émotion ou d’appartenance tribale. Bien qu'il reconnaisse que les déclarations politiques n'ont pas toujours pour objectif la vérité, cette définition est cruciale.
Au sein de la sous-section intitulée « La vérité en tant que valeur démocratique », Lynch pose une question fondamentale : « les sociétés engagées dans la politique démocratique ont-elles une raison d'encourager et de promouvoir la croyance en ce qui est vrai en soi? ». Sa réponse est un « oui » retentissant, soulignant l'impératif catégorique pour les démocraties de cultiver un environnement où la vérité est non seulement valorisée, mais activement recherchée.
L'approche de Lynch, qui définit la vérité politique comme une « norme constitutive de la croyance », est loin d'être une simple description ; elle est profondément prescriptive. Dès lors, toute déclaration qui ne relève pas d'une croyance et qui n'est pas destinée à être vérifiable se soustrait au domaine où la vérité s'applique. Cette perspective suggère qu'une part significative de la communication politique contemporaine, en particulier sur les médias sociaux, pourrait délibérément éluder cette norme en privilégiant l'excitation émotionnelle ou la signalisation tribale au détriment de l'assertion factuelle, se dérobant ainsi à toute exigence de véracité.
Cette analyse préfigure sa critique incisive des « Twitbookiens ». La vérité, sous cet angle, transcende la simple factualité ; elle constitue une norme cardinale qui devrait structurer la formation et l'expression des croyances politiques, opérant une distinction nette entre l'enquête authentique et la pure rhétorique et/ou la signalisation tribale. Lynch forge le néologisme « Twitbookiens » pour désigner ces individus qui, particulièrement sur les plateformes de médias sociaux, « ne disent ni la vérité au pouvoir ni n'exercent leur agence épistémique ». Ces acteurs tendent à « soutenir viscéralement leurs causes sans rendre compte des faits ou des complexités souvent subtiles de la vérité », ignorant fréquemment les données vérifiables et la pluralité des perspectives. Ce comportement contribue activement à ce que Lynch qualifie de « culture de l'information corrompue ».
L'adhésion inébranlable de Lynch à la tradition pragmatiste américaine, notamment à travers les idées de John Dewey et Charles Sanders Peirce, éclaire sa conception de la vérité : non pas une idée fixe et immuable (à la manière platonicienne) ni une simple construction sociale, mais plutôt une entité dynamique, découverte par une enquête et une expérience continues. En ancrant la vérité dans le pragmatisme, Lynch propose une alternative robuste tant au fondationnalisme rigide qu'au relativisme radical (tel qu'incarné par certaines interprétations de Rorty), qu'il perçoit comme des forces sapant la possibilité même de la vérité politique et de la responsabilité. Cette approche s'avère cruciale pour réhabiliter le concept de vérité à l'ère de la « post-vérité ». Lynch mobilise ainsi le pragmatisme pour défendre une compréhension de la vérité fondée sur l'enquête, essentielle à la délibération démocratique, offrant un juste milieu entre le dogmatisme et le nihilisme épistémique.
Dans un régime de post-vérité, on observe que la norme s'est déplacée vers la formulation de jugements politiques sensationnalistes et dénués de nuance, visant à diaboliser les opposants afin de capter influence et adhésion via les médias sociaux. Lorsque le discours politique dégénère en un « niveau de base guidé par la passion, le ressentiment et les fausses dichotomies », la démocratie s'en trouve inévitablement affaiblie. Les médias sociaux, en particulier, exacerbent ce phénomène en facilitant le partage émotionnel de fausses nouvelles, conduisant à ce que les « affirmations justifiées par les preuves » « disparaissent aisément de la conscience collective ».
Lynch affirme avec conviction que les sociétés engagées dans la politique démocratique ont une raison impérieuse d'encourager et de promouvoir la croyance en ce qui est vrai. Il soutient que la vérité constitue une « valeur démocratique essentielle », indispensable à la pérennité d'un mode de vie démocratique. La vérité et la démocratie sont intrinsèquement « liées » , ce qui implique qu'une atteinte à l'une représente fréquemment une attaque directe contre l'autre.
La vérité est ainsi conceptualisée comme l'une des « normes épistémiques » fondamentales des démocraties libérales. La quête de la vérité agit comme un « métastandard » pour ces régimes, s'appuyant sur la relation indissociable entre la vérité, la raison et les concepts éclairés du libéralisme. L'attente que les institutions démocratiques opèrent selon la logique, la raison, les preuves et l'adhésion aux normes de vérité est une hypothèse cardinale depuis l'époque platonicienne. Les dirigeants publics, à leur tour, sont censés « dire la vérité » tant aux citoyens qu'entre eux.
Pour qu'une proposition politique atteigne la validité, Lynch postule qu'elle doit parvenir à une « supercohérence » et, in fine, à une « concordance » avec des idées logiques, des expériences et des preuves pertinentes, tant au sein qu'en dehors de la sphère politique. La « concordance » est une théorie de la vérité ancrée dans le pragmatisme, dérivée des travaux de Peirce, où la vérité est définie en termes de durabilité à long terme, d'indéfectibilité, ou de ce qui serait cru 'à la fin de l'enquête ». Ce concept de concordance, développé par Lynch, vise précisément à élucider ce qui confère à une proposition politique son statut de vérité.
L'accent mis par Lynch sur la vérité comme « norme constitutive de la croyance » et son adhésion au pragmatisme (la « fin de l'enquête » de Peirce, l'importance de l'éducation chez Dewey) suggèrent que la valeur de la vérité en démocratie réside moins dans l'acquisition d'un ensemble statique de faits que dans le processus d'enquête, la recherche active de la vérité et les conditions qui rendent cette recherche possible.
Cette distinction est cruciale : elle signifie que la démocratie n'exige pas un consensus universel sur toutes les vérités, mais elle requiert un engagement sociétal envers les méthodes et les institutions qui conduisent de manière fiable à des croyances vraies. Le concept de « concordance » incarne ce processus dynamique et itératif de recherche de la vérité. Pour Lynch, la vérité en démocratie n'est pas quelque chose de statique, mais un effort collectif et continu. La vitalité d'une démocratie se mesure ainsi à sa capacité à favoriser et à protéger les moyens par lesquels ses citoyens peuvent rechercher la vérité de manière fiable et vérifiable.